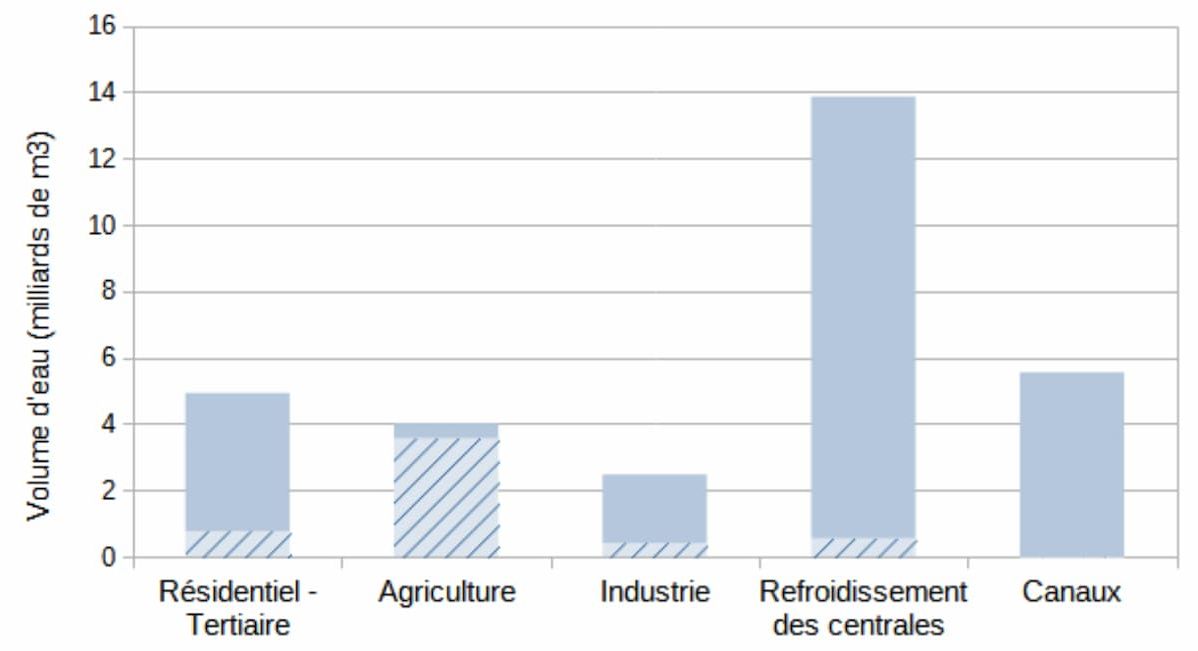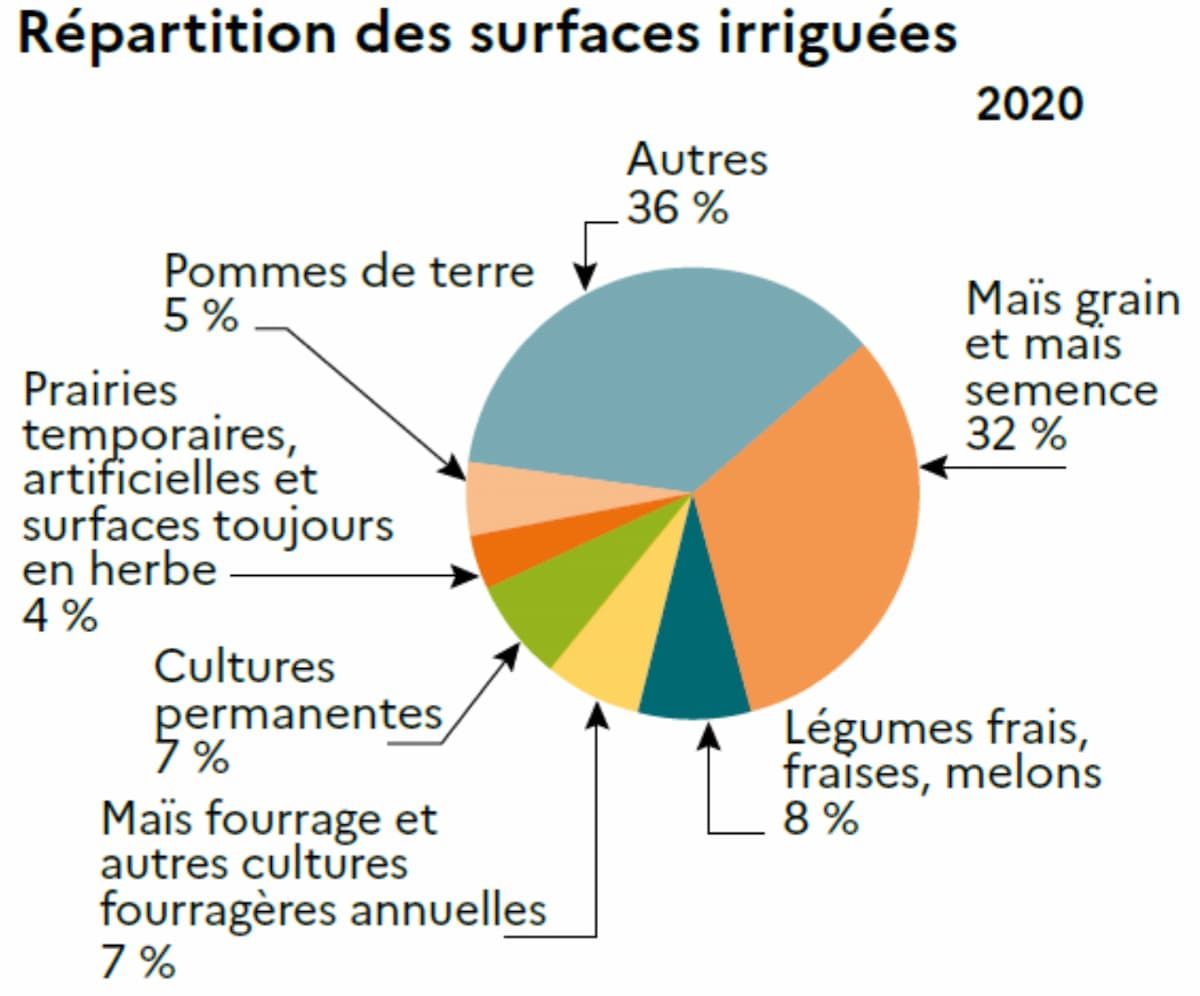En France, moins de la moitié des cours d’eau sont en bon état écologique et un tiers des eaux souterraines ou de surface sont en mauvais état chimique
[9]
. Cette situation est en grande partie due
à la pollution par les résidus d’engrais (nitrates et phosphore) et de pesticides agricoles. Près de 20 % de l’azote apporté aux champs par les engrais a été lessivé
vers les cours d’eau sur la période 2016-2020
[10]
. Les nutriments apportés par les engrais minéraux et les lisiers
sont les plus susceptibles d’être lessivés car leur libération dans le sol est rapide.
Ces polluants se retrouvent dans les nappes souterraines et parfois même dans l’eau du robinet ! Ils peuvent persister des décennies et poser des problèmes de santé publique majeurs comme la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe
. Le dépassement d’un seuil sanitaire pour un ou plusieurs polluants est fréquent et oblige à fermer des captages d’eau potable
. Notons que l’agriculture n’est pas seule responsable de la pollution des milieux aquatiques, les eaux usées domestiques ou industrielles participent elles aussi aux problèmes : nitrates et phosphates
[11]
, métaux lourds, microplastiques, PFAS, résidus médicamenteux, etc.
Pourtant, la quantité d’engrais consommés par le secteur agricole a diminué depuis les années 1980
[12]
et des progrès indéniables ont été faits pour limiter le lessivage des nutriments vers les cours d’eau (amélioration des techniques et des calendriers d’épandage d’engrais, implantation de couverts végétaux pour piéger les nutriments, meilleur stockage des lisiers et des fumiers). Malgré tout, le cycle de l’azote reste aujourd’hui complètement déséquilibré et retrouver le surplus d’azote dans les milieux aquatiques n’a rien de surprenant. Et le dérèglement climatique ne va pas arranger les choses :
les épisodes de sécheresse aggravent la pollution des eaux car les molécules problématiques y sont alors davantage concentrées et la chaleur augmente la prolifération des microorganismes. Certains territoires sensibles aux sécheresses comme le Jura font ainsi face à une dégradation des cours d’eau qui s’aggrave, malgré une agriculture relativement extensive
.